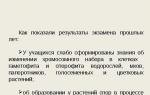Les oxydes, leur classification et leurs propriétés constituent la base d'une science aussi importante que la chimie. Ils commencent à être étudiés dès la première année d'études de chimie. Dans des sciences aussi exactes que les mathématiques, la physique et la chimie, tout le matériel est interconnecté, c'est pourquoi l'incapacité à maîtriser le matériel entraîne un manque de compréhension de nouveaux sujets. Il est donc très important de comprendre le sujet des oxydes et de bien le comprendre. Nous allons essayer d'en parler plus en détail aujourd'hui.
Que sont les oxydes ?
Les oxydes, leur classification et leurs propriétés sont ce qu'il faut d'abord comprendre. Alors, que sont les oxydes ? Vous souvenez-vous de cela à l'école ?
Les oxydes (ou oxydes) sont des composés binaires qui contiennent des atomes d'un élément électronégatif (moins électronégatif que l'oxygène) et de l'oxygène avec un état d'oxydation de -2.
Les oxydes sont des substances incroyablement courantes sur notre planète. Des exemples de composés d'oxyde comprennent l'eau, la rouille, certains colorants, le sable et même le dioxyde de carbone.

Formation d'oxydes
Les oxydes peuvent être obtenus de différentes manières. La formation d'oxydes est également étudiée par une science telle que la chimie. Les oxydes, leur classification et leurs propriétés - c'est ce que les scientifiques doivent savoir pour comprendre comment tel ou tel oxyde s'est formé. Par exemple, ils peuvent être obtenus en combinant directement un ou plusieurs atomes d'oxygène avec un élément chimique - c'est l'interaction d'éléments chimiques. Cependant, il existe également une formation indirecte d'oxydes, c'est-à-dire lorsque des oxydes sont formés par la décomposition d'acides, de sels ou de bases.

Classement des oxydes
Les oxydes et leur classification dépendent de la manière dont ils se forment. Selon leur classification, les oxydes sont divisés en deux groupes seulement, le premier étant salifiant et le second non salifiant. Examinons donc de plus près les deux groupes.
Les oxydes salifiants constituent un groupe assez important, divisé en oxydes amphotères, acides et basiques. À la suite de toute réaction chimique, les oxydes salifiants forment des sels. En règle générale, la composition des oxydes formant des sels comprend des éléments métalliques et non métalliques, qui forment des acides à la suite d'une réaction chimique avec l'eau, mais lorsqu'ils interagissent avec des bases, ils forment les acides et les sels correspondants.
Les oxydes non salifiants sont les oxydes qui ne forment pas de sels à la suite d'une réaction chimique. Des exemples de tels oxydes comprennent le carbone.
Oxydes amphotères
Les oxydes, leur classification et leurs propriétés sont des concepts très importants en chimie. La composition des composés salifiants comprend des oxydes amphotères.
Les oxydes amphotères sont des oxydes qui peuvent présenter des propriétés basiques ou acides, selon les conditions des réactions chimiques (ils présentent une amphotéricité). De tels oxydes se forment (cuivre, argent, or, fer, ruthénium, tungstène, rutherfordium, titane, yttrium et bien d'autres). Les oxydes amphotères réagissent avec des acides forts et, à la suite d'une réaction chimique, forment des sels de ces acides.

Oxydes acides
Les anhydrides sont des oxydes qui présentent et forment également des acides contenant de l'oxygène lors de réactions chimiques. Les anhydrides sont toujours formés par des non-métaux typiques, ainsi que par certains éléments chimiques de transition.
Les oxydes, leur classification et leurs propriétés chimiques sont des concepts importants. Par exemple, les oxydes acides ont des propriétés chimiques complètement différentes de celles des oxydes amphotères. Par exemple, lorsqu'un anhydride réagit avec l'eau, un acide correspondant se forme (à l'exception du SiO2 - les anhydrides réagissent avec les alcalis et, à la suite de telles réactions, de l'eau et de la soude sont libérées. Lors de la réaction avec, un sel se forme.

Oxydes basiques
Les oxydes basiques (du mot « base ») sont des oxydes d'éléments chimiques de métaux avec des états d'oxydation +1 ou +2. Ceux-ci comprennent les métaux alcalins et alcalino-terreux, ainsi que l’élément chimique magnésium. Les oxydes basiques diffèrent des autres en ce sens qu’ils sont capables de réagir avec les acides.
Les oxydes basiques interagissent avec les acides, contrairement aux oxydes acides, ainsi qu'avec les alcalis, l'eau et d'autres oxydes. À la suite de ces réactions, des sels se forment généralement.

Propriétés des oxydes
Si vous étudiez attentivement les réactions de divers oxydes, vous pouvez tirer des conclusions indépendantes sur les propriétés chimiques dont sont dotés les oxydes. La propriété chimique commune à absolument tous les oxydes est le processus redox.
Néanmoins, tous les oxydes sont différents les uns des autres. La classification et les propriétés des oxydes sont deux sujets interdépendants.
Oxydes non salifiants et leurs propriétés chimiques
Les oxydes non salifiants sont un groupe d'oxydes qui ne présentent ni propriétés acides, basiques ou amphotères. À la suite de réactions chimiques avec des oxydes non salifiants, aucun sel n’est formé. Auparavant, ces oxydes n'étaient pas appelés non salifiants, mais indifférents et indifférents, mais ces noms ne correspondent pas aux propriétés des oxydes non salifères. Selon leurs propriétés, ces oxydes sont tout à fait capables de réactions chimiques. Mais il existe très peu d'oxydes non salifiants : ils sont formés de non-métaux monovalents et divalents.
À partir d'oxydes non salifiants, des oxydes salifiants peuvent être obtenus à la suite d'une réaction chimique.

Nomenclature
Presque tous les oxydes sont généralement appelés ainsi : le mot « oxyde », suivi du nom de l'élément chimique au génitif. Par exemple, Al2O3 est de l'oxyde d'aluminium. En langage chimique, cet oxyde se lit ainsi : aluminium 2 o 3. Certains éléments chimiques, comme le cuivre, peuvent avoir plusieurs degrés d'oxydation, en conséquence, les oxydes seront également différents. Ensuite, l'oxyde de CuO est de l'oxyde de cuivre (deux), c'est-à-dire avec un degré d'oxydation de 2, et l'oxyde de Cu2O est de l'oxyde de cuivre (trois), qui a un degré d'oxydation de 3.
Mais il existe d'autres noms pour les oxydes, qui se distinguent par le nombre d'atomes d'oxygène contenus dans le composé. Les monoxydes ou monoxydes sont les oxydes qui ne contiennent qu'un seul atome d'oxygène. Les dioxydes sont les oxydes qui contiennent deux atomes d'oxygène, indiqués par le préfixe « di ». Les trioxydes sont des oxydes qui contiennent déjà trois atomes d'oxygène. Les noms tels que monoxyde, dioxyde et trioxyde sont déjà dépassés, mais on les retrouve souvent dans les manuels scolaires, les livres et autres supports.
Il existe également des noms dits triviaux pour les oxydes, c'est-à-dire ceux qui se sont développés historiquement. Par exemple, le CO est l'oxyde ou le monoxyde de carbone, mais même les chimistes appellent le plus souvent cette substance monoxyde de carbone.

Ainsi, un oxyde est un composé d’oxygène avec un élément chimique. La principale science qui étudie leur formation et leurs interactions est la chimie. Les oxydes, leur classification et leurs propriétés sont plusieurs sujets importants dans la science chimique, sans comprendre lesquels on ne peut pas tout comprendre. Les oxydes sont des gaz, des minéraux et des poudres. Certains oxydes méritent d'être connus en détail non seulement par les scientifiques, mais aussi par les gens ordinaires, car ils peuvent même être dangereux pour la vie sur cette terre. Les oxydes sont un sujet très intéressant et assez simple. Les composés d'oxydes sont très courants dans la vie quotidienne.
Dans les tâches de l'examen d'État unifié, il y a des questions dans lesquelles vous devez déterminer le type d'oxyde. Tout d’abord, il y a quatre types d’oxydes à retenir :
1) non salifiant
2) basique
3) acide
4) amphotère
Les oxydes basiques, acides et amphotères sont également souvent regroupés oxydes salifiants.
Sans entrer dans les détails théoriques, je présenterai un algorithme étape par étape pour déterminer le type d'oxyde.
D'abord- déterminer : l'oxyde métallique devant vous ou l'oxyde non métallique.
Deuxième- Après avoir établi quel oxyde métallique ou non métallique se trouve devant vous, déterminez l'état d'oxydation de l'élément qu'il contient et utilisez le tableau ci-dessous. Naturellement, les règles d'attribution des oxydes dans ce tableau doivent être apprises. Au début, vous pouvez résoudre des tâches en le regardant, mais votre objectif est de vous en souvenir, car il n'y a aucune source d'information dans l'examen à l'exception du tableau D.I. Vous n’aurez pas de tableau périodique, de tableaux de solubilité ou de séries d’activités pour les métaux.
|
Oxyde non métallique |
Oxyde métallique |
|
1) État d'oxydation du non-métal +1 ou +2 Conclusion : oxyde non salifiant Exception : Cl 2 O n'est pas un oxyde non salifiant |
1) L'état d'oxydation du métal est +1, +2 Conclusion : l'oxyde métallique est basique Exception:BeO,ZnO, SnO et PbO ne sont pas inclusaux oxydes basiques !! |
|
2) L'état d'oxydation est supérieur ou égal à +3 Conclusion : oxyde d'acide Exception : Cl 2 O est un oxyde acide, malgré l'état d'oxydation du chlore +1 |
2) État d'oxydation du métal +3, +4, Conclusion : l'oxyde est amphotère. Exception : BeO, ZnO, SnO et PbOamphotère, malgré l'état d'oxydation +2 des métaux |
|
3) État d'oxydation du métal +5,+6,+7 Conclusion : oxyde acide. |
Exemples:
Exercice: déterminer le type d’oxyde de MgO.
Solution: MgO est un oxyde métallique et l'état d'oxydation du métal qu'il contient est +2. Tous les oxydes métalliques aux états d'oxydation +1 et +2 sont basiques, à l'exception de l'oxyde de béryllium ou de zinc.
Répondre: MgO est le principal oxyde.
Exercice: déterminer le type d'oxyde Mn 2 O 7
Solution: Mn 2 O 7 est un oxyde métallique et l'état d'oxydation du métal dans cet oxyde est +7. Les oxydes métalliques aux états d'oxydation élevés (+5, +6, +7) sont classés comme acides.
Répondre: Mn 2 O 7 – oxyde acide
Exercice: déterminer le type d'oxyde Cr 2 O 3.
Solution: Cr 2 O 3 est un oxyde métallique et l'état d'oxydation du métal dans cet oxyde est +3. Les oxydes métalliques aux états d'oxydation +3 et +4 sont classés comme amphotères.
Répondre: Cr 2 O 3 est un oxyde amphotère.
Exercice: déterminer le type d'oxyde N 2 O.
Solution: N 2 O est un oxyde non métallique et l'état d'oxydation du non métallique dans cet oxyde est +1. Les oxydes non métalliques aux états d'oxydation +1 et +2 ne forment pas de sel.
Répondre: N 2 O est un oxyde non salifiant.
Exercice: déterminer le type d’oxyde BeO.
Solution: L'oxyde de béryllium ainsi que l'oxyde de zinc font exception. Bien que l’état d’oxydation des métaux qu’ils contiennent soit +2, ils sont amphotères.
Répondre: BeO est un oxyde amphotère.
Vous pouvez vous familiariser avec les propriétés chimiques des oxydes
Les oxydes sont des substances complexes constituées de deux éléments, dont l'un est l'oxygène au deuxième état d'oxydation.
Dans la littérature chimique, les règles suivantes sont suivies pour la nomenclature des oxydes :
- Lors de l'écriture de formules, l'oxygène est toujours placé en deuxième position - NON, CaO.
- Lors de la dénomination des oxydes, le mot oxyde est toujours utilisé en premier, suivi du nom du deuxième élément au génitif : BaO - oxyde de baryum, K₂O - oxyde de potassium.
- Dans le cas où un élément forme plusieurs oxydes, après son nom l'élément est indiqué entre parenthèses, par exemple N₂O₅ - (V), Fe₂O₃ - oxyde de fer (II), Fe₂O₃ - oxyde de fer (III).
- Lors de la nomination des oxydes les plus courants, il est impératif d'indiquer les rapports d'atomes dans la molécule avec les chiffres grecs correspondants : N₂O - oxyde de diazote, NO₂ - dioxyde d'azote, N₂O₅ - pentoxyde de diazote, NO - monoxyde d'azote.
- Il est conseillé de nommer les anhydrides de la même manière que les oxydes (par exemple, N₂O₅ - (V)).
Les oxydes peuvent être préparés de plusieurs manières différentes :
- Interaction avec l'oxygène de substances simples. Les substances simples s'oxydent lorsqu'elles sont chauffées, libérant souvent de la chaleur et de la lumière. Ce processus est appelé combustion
C + O₂ = CO₂ - L'oxydation produit des oxydes d'éléments qui sont inclus dans la substance d'origine :
2H₂S + 3O₂ = 2 H₂O + 2 SO₂ - Décomposition des nitrates, hydroxydes, carbonates :
2Cu(NO₃)₂ = 2CuO + 4NO₂ + O₂
CaCO₃ = CaO + CO₂
Cu(OH)₂ = CuO + H₂O - À la suite de l'oxydation des métaux par des oxydes d'autres éléments. De telles réactions sont devenues la base de la métallothermie - la réduction des métaux de leurs oxydes à l'aide de métaux plus actifs :
2Al + Cr₂O₃ = 2Cr ±Al₂O₃ - Par décomposition ou oxydation complémentaire des inférieurs :
4CrO₃ = 2Cr₂O₃ + 3O₃
4FeO + O₂ = 2Fe₂O₃
4CO + O₂ = 2CO₂
La classification des oxydes en fonction de leurs propriétés chimiques consiste à les diviser en oxydes salifiants et non salifiants (indifférents). Les oxydes salifiants, à leur tour, sont divisés en acides, basiques et amphotères.
Oxydes basiques les bases correspondent. Par exemple, Na₂O, CaO, MgO sont des oxydes basiques, puisqu'ils correspondent aux bases - NaOH, Ca(OH)₂, Mg(OH)₂. Certains oxydes (K₂O et CaO) réagissent facilement avec l'eau et forment les bases correspondantes :
CaO + H₂O = Ca(OH)₂
K₂O + H₂O = 2KOH
Les oxydes Fe₂O₃, CuO, Ag₂O ne réagissent pas avec l'eau, mais neutralisent les acides, c'est pourquoi ils sont considérés comme basiques :
Fe₂O₃, + 6HCl = 2FeCl₃ + 3H₂OCuO + H₂SO₄ + H₂O
Ag₂O + 2HNO₃ = 2AgNO₃ + H₂O
Les propriétés chimiques typiques des oxydes de ce type sont leur réaction avec des acides, à la suite de laquelle, en règle générale, de l'eau et du sel se forment :
FeO + 2HCl = FeCl₂ + H₂O
Les oxydes basiques réagissent également avec les oxydes acides :
CaO + CO₂ = CaCO₃.
Oxydes acides correspondent aux acides. Par exemple, l'oxyde N₂O₃ correspond à HNO₂, Cl₂O₇ - HClO₄, SO₃ - acide sulfurique H₂SO₄.
La principale propriété chimique de ces oxydes est leur réaction avec des bases, formant du sel et de l'eau :
2NaOH + CO₂ = NaCO₃ + H₂O
La plupart des oxydes acides réagissent avec l'eau pour former les acides correspondants. En même temps, l'oxyde SiO₂ est pratiquement insoluble dans l'eau, mais il neutralise les bases, c'est donc un oxyde acide :
2NaOH + SiO₂ = (fusion) Na₂siO₃ + H₂O
Oxydes amphotères- ce sont des oxydes qui, selon les conditions, présentent des propriétés acides et basiques, c'est-à-dire Lorsqu'ils interagissent avec des acides, ils se comportent comme des oxydes basiques et lorsqu'ils interagissent avec des bases, ils se comportent comme des oxydes acides.
Tous les oxydes amphotères ne réagissent pas de la même manière avec les bases et les acides. Certains ont des propriétés basiques plus prononcées, d’autres ont des propriétés plus acides.
Si l'oxyde de zinc ou de chrome réagit de manière égale avec les acides et les bases, alors l'oxyde de Fe₂O₃ a des propriétés basiques prédominantes.
Les propriétés des oxydes amphotères sont illustrées à l'aide de l'exemple du ZnO :
ZnO + 2HCl = ZnCl₂ + H₂O
ZnO + 2NaOH = Na₂ZnO₂ + H₂O
Les oxydes non salifiants ne forment ni acides ni bases (par exemple N₂O, NO).
De plus, ils ne donnent pas de réactions caractéristiques des oxydes salifiants. Les oxydes non salifiants peuvent réagir avec des acides ou des alcalis, mais dans ce cas, les produits caractéristiques des oxydes salifiants ne se forment pas, par exemple, à 150⁰C et 1,5 MPa, le CO réagit avec l'hydroxyde de sodium pour former un sel - formiate de sodium :
CO + NaOH = HCOONa
Les oxydes non salifiants ne sont pas aussi répandus que les autres types d'oxydes et se forment principalement avec la participation de non-métaux divalents.
Oxydes.
Ce sont des substances complexes constituées de DEUX éléments, dont l’oxygène. Par exemple:
CuO – oxyde de cuivre (II)
AI 2 O 3 – oxyde d'aluminium
SO 3 – oxyde de soufre (VI)
Les oxydes sont divisés (classés) en 4 groupes :
Na 2 O – Oxyde de sodium
CaO – Oxyde de calcium
Fe 2 O 3 – oxyde de fer (III)
2). Acide– Ce sont des oxydes non-métaux. Et parfois des métaux si le degré d'oxydation du métal est > 4. Par exemple :
CO 2 – Monoxyde de carbone (IV)
P 2 O 5 – Oxyde de phosphore (V)
SO 3 – Oxyde de soufre (VI)
3). Amphotère– Ce sont des oxydes qui possèdent les propriétés des oxydes à la fois basiques et acides. Vous devez connaître les cinq oxydes amphotères les plus courants :
BeO – oxyde de béryllium
ZnO – Oxyde de Zinc
AI 2 O 3 – Oxyde d'aluminium
Cr 2 O 3 – Oxyde de chrome (III)
Fe 2 O 3 – Oxyde de fer (III)
4). Non salifiant (indifférent)– Ce sont des oxydes qui ne présentent les propriétés des oxydes basiques ou acides. Il y a trois oxydes à retenir :
CO – monoxyde de carbone (II) monoxyde de carbone
NON – oxyde nitrique (II)
N 2 O – protoxyde d’azote (I) gaz hilarant, protoxyde d’azote
Méthodes de production d'oxydes.
1). La combustion, c'est-à-dire interaction avec l'oxygène d'une substance simple :
4Na + O 2 = 2Na 2 O
4P + 5O 2 = 2P 2 O 5
2). La combustion, c'est-à-dire interaction avec l'oxygène d'une substance complexe (constituée de deux éléments) formant ainsi deux oxydes.
2ZnS + 3O 2 = 2ZnO + 2SO 2
4FeS 2 + 11O 2 = 2Fe 2 O 3 + 8SO 2
3). Décomposition trois acides faibles. D'autres ne se décomposent pas. Dans ce cas, de l'oxyde d'acide et de l'eau se forment.
H 2 CO 3 = H 2 O + CO 2
H 2 SO 3 = H 2 O + SO 2
H 2 SiO 3 = H 2 O + SiO 2
4). Décomposition insoluble terrains. Un oxyde basique et de l'eau se forment.
Mg(OH) 2 = MgO + H 2 O
2Al(OH) 3 = Al 2 O 3 + 3H 2 O
5). Décomposition insoluble sels Un oxyde basique et un oxyde acide se forment.
CaCO 3 = CaO + CO 2
MgSO 3 = MgO + SO 2
Propriétés chimiques.
je. Oxydes basiques.
alcali.
Na 2 O + H 2 O = 2NaOH
CaO + H 2 O = Ca(OH)2
СuO + H 2 O = la réaction ne se produit pas, car base possible contenant du cuivre - insoluble
2). Interaction avec les acides, entraînant la formation de sel et d'eau. (L'oxyde de base et les acides réagissent TOUJOURS)
K2O + 2HCI = 2KCl + H2O
CaO + 2HNO 3 = Ca(NO 3) 2 + H 2 O
3). Interaction avec des oxydes acides, entraînant la formation de sel.
Li 2 O + CO 2 = Li 2 CO 3
3MgO + P 2 O 5 = Mg 3 (PO 4) 2
4). L'interaction avec l'hydrogène produit du métal et de l'eau.
CuO + H 2 = Cu + H 2 O
Fe 2 O 3 + 3H 2 = 2Fe + 3H 2 O
II.Oxydes acides.
1). Une interaction avec l'eau devrait se former acide.(SeulementSiO 2 n'interagit pas avec l'eau)
CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3
P2O5 + 3H2O = 2H3PO4
2). Interaction avec des bases solubles (alcalis). Cela produit du sel et de l'eau.
SO 3 + 2KOH = K 2 SO 4 + H 2 O
N 2 O 5 + 2KOH = 2KNO 3 + H 2 O
3). Interaction avec les oxydes basiques. Dans ce cas, seul du sel se forme.
N 2 O 5 + K 2 O = 2KNO 3
Al 2 O 3 + 3SO 3 = Al 2 (SO 4) 3
Exercices de base.
1). Complétez l’équation de la réaction. Déterminez son type.
K 2 O + P 2 O 5 =
Solution.
Pour écrire ce qui en résulte, il faut déterminer quelles substances ont réagi - ici il s'agit de l'oxyde de potassium (basique) et de l'oxyde de phosphore (acide) selon les propriétés - le résultat doit être du SEL (voir propriété n°3 ) et le sel est constitué d'atomes de métaux (dans notre cas de potassium) et d'un résidu acide qui comprend du phosphore (c'est-à-dire PO 4 -3 - phosphate). Par conséquent
3K 2 O + P 2 O 5 = 2K 3 RO 4
type de réaction - composé (puisque deux substances réagissent, mais une se forme)
2). Réaliser des transformations (chaîne).
Ca → CaO → Ca(OH) 2 → CaCO 3 → CaO
Solution
Pour réaliser cet exercice, vous devez vous rappeler que chaque flèche représente une équation (une réaction chimique). Numérotons chaque flèche. Il est donc nécessaire d’écrire 4 équations. La substance écrite à gauche de la flèche (substance de départ) réagit et la substance écrite à droite se forme à la suite de la réaction (produit de réaction). Décryptons la première partie de l'enregistrement :
Ca + …..→ CaO On constate qu'une substance simple réagit et qu'un oxyde se forme. Connaissant les méthodes de production d'oxydes (n°1), nous arrivons à la conclusion que dans cette réaction il faut ajouter de l'oxygène (O 2)
2Ca + O2 → 2CaO
Passons à la transformation n°2
CaO → Ca(OH)2
CaO + ……→ Ca(OH)2
Nous arrivons à la conclusion qu'il est nécessaire d'appliquer ici la propriété des oxydes basiques - interaction avec l'eau, car seulement dans ce cas, une base est formée à partir de l'oxyde.
CaO + H 2 O → Ca(OH) 2
Passons à la transformation n°3
Ca(OH)2 → CaCO3
Ca(OH) 2 + ….. = CaCO 3 + …….
Nous arrivons à la conclusion qu'il s'agit ici de dioxyde de carbone CO 2 car ce n'est qu'en interagissant avec les alcalis qu'il forme un sel (voir propriété n°2 des oxydes d'acide)
Ca(OH) 2 + CO 2 = CaCO 3 + H 2 O
Passons à la transformation n°4
CaCO 3 → CaO
CaCO 3 = ….. CaO + ……
Nous arrivons à la conclusion qu'il se forme ici plus de CO 2, car Le CaCO 3 est un sel insoluble et c'est lors de la décomposition de ces substances que se forment des oxydes.
CaCO 3 = CaO + CO 2
3). Avec laquelle des substances suivantes le CO 2 interagit-il ? Écrivez les équations de réaction.
UN). Acide chlorhydrique B). Hydroxyde de sodium B). Oxyde de potassium d). Eau
D). Hydrogène E). Oxyde de soufre (IV).
Nous déterminons que le CO 2 est un oxyde acide. Et les oxydes acides réagissent avec l'eau, les alcalis et les oxydes basiques... Par conséquent, dans la liste donnée, nous sélectionnons les réponses B, C, D Et c'est avec elles que nous écrivons les équations de réaction :
1). CO 2 + 2NaOH = Na 2 CO 3 + H 2 O
2). CO 2 + K 2 O = K 2 CO 3
Avant de commencer à parler des propriétés chimiques des oxydes, nous devons nous rappeler que tous les oxydes sont divisés en 4 types, à savoir basiques, acides, amphotères et non salifiants. Afin de déterminer le type d'un oxyde, vous devez tout d'abord comprendre s'il s'agit d'un oxyde métallique ou non métallique devant vous, puis utiliser l'algorithme (vous devez l'apprendre !) présenté dans le tableau suivant. :
| Oxyde non métallique | Oxyde métallique |
| 1) État d'oxydation du non-métal +1 ou +2 Conclusion : oxyde non salifiant Exception : Cl 2 O n'est pas un oxyde non salifiant |
1) État d'oxydation du métal +1 ou +2 Conclusion : l'oxyde métallique est basique Exception : BeO, ZnO et PbO ne sont pas des oxydes basiques |
| 2) L'état d'oxydation est supérieur ou égal à +3 Conclusion : oxyde d'acide Exception : Cl 2 O est un oxyde acide, malgré l'état d'oxydation du chlore +1 |
2) État d'oxydation du métal +3 ou +4 Conclusion : oxyde amphotère Exception : BeO, ZnO et PbO sont amphotères, malgré l'état d'oxydation +2 des métaux 3) État d'oxydation du métal +5, +6, +7 Conclusion : oxyde d'acide |
En plus des types d'oxydes indiqués ci-dessus, nous présenterons également deux autres sous-types d'oxydes basiques, en fonction de leur activité chimique, à savoir oxydes basiques actifs Et oxydes basiques peu actifs.
- À oxydes basiques actifs Nous incluons les oxydes de métaux alcalins et alcalino-terreux (tous les éléments des groupes IA et IIA, à l'exception de l'hydrogène H, du béryllium Be et du magnésium Mg). Par exemple, Na 2 O, CaO, Rb 2 O, SrO, etc.
- À oxydes basiques peu actifs nous inclurons tous les principaux oxydes qui ne sont pas inclus dans la liste oxydes basiques actifs. Par exemple, FeO, CuO, CrO, etc.
Il est logique de supposer que les oxydes basiques actifs entrent souvent dans des réactions que les oxydes faiblement actifs ne font pas.
Il convient de noter que malgré le fait que l'eau soit en fait un oxyde d'un non-métal (H 2 O), ses propriétés sont généralement considérées indépendamment des propriétés des autres oxydes. Cela est dû à sa répartition particulièrement importante dans le monde qui nous entoure et c'est pourquoi, dans la plupart des cas, l'eau n'est pas un réactif, mais un milieu dans lequel d'innombrables réactions chimiques peuvent avoir lieu. Cependant, il participe souvent directement à diverses transformations, notamment certains groupes d'oxydes réagissent avec lui.
Quels oxydes réagissent avec l'eau ?
De tous les oxydes avec de l'eau réagir
seulement:
1) tous les oxydes basiques actifs (oxydes de métaux alcalins et de métaux alcalins) ;
2) tous les oxydes d'acide, à l'exception du dioxyde de silicium (SiO 2) ;
ceux. De ce qui précède, il s'ensuit qu'avec de l'eau exactement ne réagis pas:
1) tous les oxydes basiques peu actifs ;
2) tous les oxydes amphotères ;
3) oxydes non salifiants (NO, N 2 O, CO, SiO).
La possibilité de déterminer quels oxydes peuvent réagir avec l'eau même sans la possibilité d'écrire les équations de réaction correspondantes vous permet déjà d'obtenir des points pour certaines questions de la partie test de l'examen d'État unifié.
Voyons maintenant comment certains oxydes réagissent avec l'eau, c'est-à-dire Apprenons à écrire les équations de réaction correspondantes.
Oxydes basiques actifs, réagissant avec l'eau, forment leurs hydroxydes correspondants. Rappelons que l'oxyde métallique correspondant est un hydroxyde qui contient le métal dans le même état d'oxydation que l'oxyde. Ainsi, par exemple, lorsque les oxydes basiques actifs K +1 2 O et Ba +2 O réagissent avec l'eau, leurs hydroxydes correspondants K +1 OH et Ba +2 (OH) 2 se forment :
K2O + H2O = 2KOH- l'hydroxyde de potassium
BaO + H 2 O = Ba(OH)2– hydroxyde de baryum
Tous les hydroxydes correspondant aux oxydes basiques actifs (oxydes de métaux alcalins et de métaux alcalins) appartiennent aux alcalis. Les alcalis sont tous des hydroxydes métalliques hautement solubles dans l'eau, ainsi que de l'hydroxyde de calcium peu soluble Ca(OH) 2 (à titre exceptionnel).
L'interaction des oxydes acides avec l'eau, ainsi que la réaction des oxydes basiques actifs avec l'eau, conduisent à la formation des hydroxydes correspondants. Ce n'est que dans le cas des oxydes acides qu'ils correspondent non pas à des oxydes basiques, mais à des hydroxydes acides, plus souvent appelés acides contenant de l'oxygène. Rappelons que l'oxyde acide correspondant est un acide oxygéné qui contient un élément acidogène dans le même état d'oxydation que dans l'oxyde.
Ainsi, si l'on veut, par exemple, écrire l'équation de l'interaction de l'oxyde acide SO 3 avec l'eau, il faut tout d'abord rappeler les principaux acides soufrés étudiés dans le programme scolaire. Il s'agit du sulfure d'hydrogène H 2 S, des acides sulfureux H 2 SO 3 et sulfurique H 2 SO 4. Comme il est facile de le voir, l'acide sulfure d'hydrogène H 2 S ne contient pas d'oxygène, sa formation lors de l'interaction du SO 3 avec l'eau peut donc être immédiatement exclue. Parmi les acides H 2 SO 3 et H 2 SO 4, seul l'acide sulfurique H 2 SO 4 contient du soufre à l'état d'oxydation +6, comme dans l'oxyde SO 3. C'est donc précisément cela qui se formera lors de la réaction du SO 3 avec l'eau :
H 2 O + SO 3 = H 2 SO 4
De même, l'oxyde N 2 O 5, contenant de l'azote à l'état d'oxydation +5, réagissant avec l'eau, forme de l'acide nitrique HNO 3, mais en aucun cas du HNO 2 nitreux, puisque dans l'acide nitrique l'état d'oxydation de l'azote est le même que dans N 2 O 5 , est égal à +5, et dans l'azote - +3 :
N +5 2 O 5 + H 2 O = 2HN +5 O 3
Interaction des oxydes entre eux
Tout d'abord, il faut bien comprendre que parmi les oxydes salifiants (acides, basiques, amphotères), les réactions ne se produisent presque jamais entre les oxydes d'une même classe, c'est-à-dire Dans la grande majorité des cas, l’interaction est impossible :
1) oxyde basique + oxyde basique ≠
2) oxyde d'acide + oxyde d'acide ≠
3) oxyde amphotère + oxyde amphotère ≠
Alors qu'une interaction est presque toujours possible entre des oxydes appartenant à des types différents, c'est-à-dire presque toujours fuient réactions entre :
1) oxyde basique et oxyde acide ;
2) oxyde amphotère et oxyde acide ;
3) oxyde amphotère et oxyde basique.
À la suite de toutes ces interactions, le produit est toujours du sel moyen (normal).
Examinons plus en détail toutes ces paires d’interactions.
Résultat de l’interaction :
Me x O y + oxyde d'acide, où Me x O y – oxyde métallique (basique ou amphotère)
il se forme un sel constitué du cation métallique Me (issu du Me x O y initial) et du résidu acide de l'acide correspondant à l'oxyde d'acide.
À titre d'exemple, essayons d'écrire les équations d'interaction pour les paires de réactifs suivantes :
Na 2 O + P 2 O 5 Et Al 2 O 3 + SO 3
Dans la première paire de réactifs, nous voyons un oxyde basique (Na 2 O) et un oxyde acide (P 2 O 5). Dans le second - oxyde amphotère (Al 2 O 3) et oxyde acide (SO 3).
Comme déjà mentionné, à la suite de l'interaction d'un oxyde basique/amphotère avec un acide, un sel se forme, constitué d'un cation métallique (de l'oxyde basique/amphotère d'origine) et d'un résidu acide de l'acide correspondant au oxyde acide d'origine.
Ainsi, l'interaction de Na 2 O et P 2 O 5 devrait former un sel constitué de cations Na + (de Na 2 O) et du résidu acide PO 4 3-, puisque l'oxyde P +5 2 O 5 correspond à l'acide H 3 P +5 O4. Ceux. À la suite de cette interaction, du phosphate de sodium se forme :
3Na 2 O + P 2 O 5 = 2Na 3 PO 4- phosphate de sodium
À son tour, l'interaction d'Al 2 O 3 et de SO 3 devrait former un sel constitué de cations Al 3+ (de Al 2 O 3) et du résidu acide SO 4 2-, puisque l'oxyde S +6 O 3 correspond à l'acide H 2 S +6 O4. Ainsi, à la suite de cette réaction, on obtient du sulfate d'aluminium :
Al 2 O 3 + 3SO 3 = Al 2 (SO 4) 3- du sulfate d'aluminium
Plus spécifique est l’interaction entre les oxydes amphotères et basiques. Ces réactions s'effectuent à des températures élevées et leur apparition est possible du fait que l'oxyde amphotère joue en fait le rôle d'un oxyde acide. À la suite de cette interaction, un sel d’une composition spécifique se forme, constitué d’un cation métallique formant l’oxyde basique d’origine et d’un « résidu acide »/anion, qui comprend le métal de l’oxyde amphotère. La formule générale d'un tel « résidu acide »/anion peut s'écrire MeO 2 x - , où Me est un métal issu d'un oxyde amphotère, et x = 2 dans le cas d'oxydes amphotères avec une formule générale de la forme Me + 2 O (ZnO, BeO, PbO) et x = 1 – pour les oxydes amphotères de formule générale Me +3 2 O 3 (par exemple, Al 2 O 3, Cr 2 O 3 et Fe 2 O 3).
Essayons d'écrire les équations d'interaction à titre d'exemple
ZnO + Na2O Et Al 2 O 3 + BaO
Dans le premier cas, ZnO est un oxyde amphotère de formule générale Me +2 O, et Na 2 O est un oxyde basique typique. Selon ce qui précède, à la suite de leur interaction, un sel devrait se former, constitué d'un cation métallique formant un oxyde basique, c'est-à-dire dans notre cas, Na + (de Na 2 O) et le « résidu acide »/anion de formule ZnO 2 2-, puisque l'oxyde amphotère a une formule générale de la forme Me + 2 O. Ainsi, la formule du Le sel obtenu, sous réserve de la condition de neutralité électrique de l'une de ses unités structurelles (« molécules »), ressemblera à Na 2 ZnO 2 :
ZnO + Na2O = à=> Na2ZnO2
Dans le cas d'une paire de réactifs en interaction Al 2 O 3 et BaO, la première substance est un oxyde amphotère de formule générale Me + 3 2 O 3, et la seconde est un oxyde basique typique. Dans ce cas, un sel se forme contenant un cation métallique à partir de l'oxyde principal, c'est-à-dire Ba 2+ (de BaO) et le « résidu acide »/anion AlO 2 - . Ceux. la formule du sel obtenu, sous réserve de la condition de neutralité électrique de l'une de ses unités structurelles (« molécules »), aura la forme Ba(AlO 2) 2, et l'équation d'interaction elle-même s'écrira sous la forme :
Al 2 O 3 + BaO = à=> Ba(AlO2)2
Comme nous l'avons écrit ci-dessus, la réaction se produit presque toujours :
Me x O y + oxyde d'acide,
où Me x O y est un oxyde métallique basique ou amphotère.
Cependant, il y a deux oxydes d'acide « capricieux » à retenir : le dioxyde de carbone (CO 2) et le dioxyde de soufre (SO 2). Leur « minutie » réside dans le fait que malgré leurs propriétés acides évidentes, l'activité du CO 2 et du SO 2 n'est pas suffisante pour qu'ils interagissent avec les oxydes basiques et amphotères peu actifs. Parmi les oxydes métalliques, ils réagissent uniquement avec oxydes basiques actifs(oxydes de métaux alcalins et alcalins). Par exemple, Na 2 O et BaO, étant des oxydes basiques actifs, peuvent réagir avec eux :
CO 2 + Na 2 O = Na 2 CO 3
SO 2 + BaO = BaSO 3
Alors que les oxydes CuO et Al 2 O 3, qui ne sont pas apparentés aux oxydes basiques actifs, ne réagissent pas avec le CO 2 et le SO 2 :
CO2 + CuO ≠
CO 2 + Al 2 O 3 ≠
SO 2 + CuO ≠
SO 2 + Al 2 O 3 ≠
Interaction des oxydes avec les acides
Les oxydes basiques et amphotères réagissent avec les acides. Dans ce cas, des sels et de l'eau se forment :
FeO + H 2 SO 4 = FeSO 4 + H 2 O
Les oxydes non salifiants ne réagissent pas du tout avec les acides, et les oxydes acides ne réagissent pas avec les acides dans la plupart des cas.
Quand un oxyde acide réagit-il avec un acide ?
Lors de la résolution de la partie à choix multiples de l'examen d'État unifié, vous devez supposer conditionnellement que les oxydes acides ne réagissent ni avec les oxydes acides ni avec les acides, sauf dans les cas suivants :
1) le dioxyde de silicium, étant un oxyde acide, réagit avec l'acide fluorhydrique et s'y dissout. Grâce à cette réaction, le verre peut notamment être dissous dans l’acide fluorhydrique. Dans le cas d'un excès de HF, l'équation de réaction a la forme :
SiO 2 + 6HF = H 2 + 2H 2 O,
et en cas de déficit en HF :
SiO 2 + 4HF = SiF 4 + 2H 2 O
2) SO 2, étant un oxyde acide, réagit facilement avec l'acide sulfure d'hydrogène H 2 S comme co-proportion:
S +4 O 2 + 2H 2 S -2 = 3S 0 + 2H 2 O
3) L'oxyde de phosphore (III) P 2 O 3 peut réagir avec des acides oxydants, notamment l'acide sulfurique concentré et l'acide nitrique de n'importe quelle concentration. Dans ce cas, l'état d'oxydation du phosphore passe de +3 à +5 :
| P2O3 | + | 2H2SO4 | + | H2O | =à=> | 2SO 2 | + | 2H3PO4 |
| (conc.) |
| 3 P2O3 | + | 4HNO3 | + | 7 H2O | =à=> | 4NON | + | 6 H3PO4 |
| (détaillé) |
| 2HNO3 | + | 3SO 2 | + | 2H2O | =à=> | 3H2SO4 | + | 2NON |
| (détaillé) |
Interaction des oxydes avec les hydroxydes métalliques
Les oxydes acides réagissent avec les hydroxydes métalliques, basiques et amphotères. Cela produit un sel constitué d'un cation métallique (issu de l'hydroxyde métallique d'origine) et d'un résidu acide correspondant à l'oxyde d'acide.
SO 3 + 2NaOH = Na 2 SO 4 + H 2 O
Les oxydes acides, qui correspondent aux acides polybasiques, peuvent former à la fois des sels normaux et acides avec les alcalis :
CO 2 + 2NaOH = Na 2 CO 3 + H 2 O
CO 2 + NaOH = NaHCO 3
P 2 O 5 + 6KOH = 2K 3 PO 4 + 3H 2 O
P 2 O 5 + 4KOH = 2K 2 HPO 4 + H 2 O
P 2 O 5 + 2KOH + H 2 O = 2KH 2 PO 4
Les oxydes « capricieux » CO 2 et SO 2, dont l'activité, comme déjà mentionné, n'est pas suffisante pour leur réaction avec les oxydes basiques et amphotères peu actifs, réagissent néanmoins avec la plupart des hydroxydes métalliques correspondants. Plus précisément, le dioxyde de carbone et le dioxyde de soufre réagissent avec les hydroxydes insolubles sous forme de suspension dans l'eau. Dans ce cas, seules les informations de base Ô des sels naturels appelés hydroxycarbonates et hydroxosulfites, et la formation de sels intermédiaires (normaux) est impossible :
2Zn(OH) 2 + CO 2 = (ZnOH) 2 CO 3 + H 2 O(en solution)
2Cu(OH) 2 + CO 2 = (CuOH) 2 CO 3 + H 2 O(en solution)
Cependant, le dioxyde de carbone et le dioxyde de soufre ne réagissent pas du tout avec les hydroxydes métalliques à l'état d'oxydation +3, par exemple comme Al(OH) 3, Cr(OH) 3, etc.
A noter également que le dioxyde de silicium (SiO 2 ) est particulièrement inerte, on le retrouve le plus souvent dans la nature sous forme de sable ordinaire. Cet oxyde est acide, mais parmi les hydroxydes métalliques, il n'est capable de réagir qu'avec des solutions concentrées (50 à 60 %) d'alcalis, ainsi qu'avec des alcalis purs (solides) lors de la fusion. Dans ce cas, des silicates se forment :
2NaOH + SiO2 = à=> Na 2 SiO 3 + H 2 O
Les oxydes amphotères des hydroxydes métalliques réagissent uniquement avec les alcalis (hydroxydes de métaux alcalins et alcalino-terreux). Dans ce cas, lorsque la réaction est effectuée en solutions aqueuses, des sels complexes solubles se forment :
ZnO + 2NaOH + H 2 O = Na 2- tétrahydroxozincate de sodium
BeO + 2NaOH + H 2 O = Na 2- tétrahydroxobéryllate de sodium
Al 2 O 3 + 2NaOH + 3H 2 O = 2Na- tétrahydroxyaluminate de sodium
Cr 2 O 3 + 6NaOH + 3H 2 O = 2Na 3- hexahydroxochromate de sodium (III)
Et lorsque ces mêmes oxydes amphotères sont fusionnés avec des alcalis, on obtient des sels constitués d'un cation alcalin ou alcalino-terreux et d'un anion du type MeO 2 x -, où X= 2 dans le cas d'oxyde amphotère de type Me +2 O et X= 1 pour un oxyde amphotère de la forme Me 2 +2 O 3 :
ZnO + 2NaOH = à=> Na 2 ZnO 2 + H 2 O
BeO + 2NaOH = à=> Na 2 BeO 2 + H 2 O
Al 2 O 3 + 2NaOH = à=> 2NaAlO 2 + H 2 O
Cr 2 O 3 + 2NaOH = à=> 2NaCrO 2 + H 2 O
Fe 2 O 3 + 2NaOH = à=> 2NaFeO 2 + H 2 O
Il convient de noter que les sels obtenus par fusion d'oxydes amphotères avec des alcalis solides peuvent être facilement obtenus à partir de solutions des sels complexes correspondants par évaporation et calcination ultérieure :
Na2 = à=> Na 2 ZnO 2 + 2H 2 O
Na = à=> NaAlO 2 + 2H 2 O
Interaction des oxydes avec les sels moyens
Le plus souvent, les sels moyens ne réagissent pas avec les oxydes.
Cependant, vous devez connaître les exceptions suivantes à cette règle, qui sont souvent rencontrées lors de l'examen.
L'une de ces exceptions est que les oxydes amphotères, ainsi que le dioxyde de silicium (SiO 2), lorsqu'ils sont fusionnés avec des sulfites et des carbonates, déplacent respectivement le dioxyde de soufre (SO 2) et le dioxyde de carbone (CO 2) de ces derniers. Par exemple:
Al 2 O 3 + Na 2 CO 3 = à=> 2NaAlO 2 + CO 2
SiO 2 + K 2 SO 3 = à=> K2SiO3 + SO2
En outre, les réactions des oxydes avec les sels peuvent conditionnellement inclure l'interaction du dioxyde de soufre et du dioxyde de carbone avec des solutions aqueuses ou des suspensions des sels correspondants - sulfites et carbonates, conduisant à la formation de sels acides :
Na 2 CO 3 + CO 2 + H 2 O = 2NaHCO 3
CaCO 3 + CO 2 + H 2 O = Ca(HCO 3) 2
De plus, le dioxyde de soufre, lorsqu'il passe à travers des solutions aqueuses ou des suspensions de carbonates, en déplace le dioxyde de carbone en raison du fait que l'acide sulfureux est un acide plus fort et plus stable que l'acide carbonique :
K 2 CO 3 + SO 2 = K 2 SO 3 + CO 2
ORR impliquant des oxydes
Réduction des oxydes métalliques et non métalliques
Tout comme les métaux peuvent réagir avec des solutions de sels de métaux moins actifs, déplaçant ces derniers sous forme libre, les oxydes métalliques lorsqu'ils sont chauffés sont également capables de réagir avec des métaux plus actifs.
Rappelons que l'activité des métaux peut être comparée soit à l'aide de la série d'activité des métaux, soit, si un ou deux métaux ne sont pas dans la série d'activité, par leur position l'un par rapport à l'autre dans le tableau périodique : l'inférieur et l'autre. quitte le métal, plus il est actif. Il est également utile de rappeler que tout métal de la famille AHM et ALP sera toujours plus actif qu'un métal qui n'est pas représentatif de l'ALM ou de l'ALP.
En particulier, la méthode d'aluminothermie, utilisée dans l'industrie pour obtenir des métaux aussi difficiles à réduire que le chrome et le vanadium, repose sur l'interaction d'un métal avec l'oxyde d'un métal moins actif :
Cr 2 O 3 + 2Al = à=> Al2O3 + 2Cr
Au cours du processus d'aluminothermie, une quantité colossale de chaleur est générée et la température du mélange réactionnel peut atteindre plus de 2 000 °C.
De plus, les oxydes de presque tous les métaux situés dans la série d'activités à droite de l'aluminium peuvent être réduits en métaux libres par l'hydrogène (H 2), le carbone (C) et le monoxyde de carbone (CO) lorsqu'ils sont chauffés. Par exemple:
Fe 2 O 3 + 3CO = à=> 2Fe + 3CO2
CuO+C= à=> Cu + CO
FeO + H2 = à=> Fe + H 2 O
Il est à noter que si le métal peut présenter plusieurs états d'oxydation, en cas de carence du réducteur utilisé, une réduction incomplète des oxydes est également possible. Par exemple:
Fe 2 O 3 + CO =t o=> 2FeO + CO2
4CuO + C = à=> 2Cu2O + CO2
Oxydes de métaux actifs (alcalis, alcalino-terreux, magnésium et aluminium) avec hydrogène et monoxyde de carbone ne réagis pas.
Cependant, les oxydes de métaux actifs réagissent avec le carbone, mais différemment des oxydes de métaux moins actifs.
Dans le cadre du programme d'examen d'État unifié, afin de ne pas se tromper, il faut supposer qu'à la suite de la réaction d'oxydes de métaux actifs (jusqu'à Al inclus) avec le carbone, la formation de métal alcalin libre, d'alcali le métal, le Mg et l'Al sont impossibles. Dans de tels cas, du carbure métallique et du monoxyde de carbone se forment. Par exemple:
2Al2O3 + 9C = à=> Al4C3 + 6CO
CaO + 3C = à=> CaC2 + CO
Les oxydes de non-métaux peuvent souvent être réduits par les métaux en non-métaux libres. Par exemple, lorsqu'ils sont chauffés, les oxydes de carbone et de silicium réagissent avec les métaux alcalins, alcalino-terreux et le magnésium :
CO2 + 2Mg = à=> 2MgO + C
SiO2 + 2Mg = à=>Si + 2MgO
Avec un excès de magnésium, cette dernière interaction peut également conduire à la formation siliciure de magnésium Mg2Si :
SiO2 + 4Mg = à=> Mg2Si + 2MgO
Les oxydes d'azote peuvent être réduits relativement facilement, même avec des métaux moins actifs, comme le zinc ou le cuivre :
Zn + 2NO = à=> ZnO + N2
NON 2 + 2Cu = à=> 2CuO + N2
Interaction des oxydes avec l'oxygène
Afin de pouvoir répondre à la question de savoir si un oxyde réagit avec l'oxygène (O 2) dans les tâches du véritable examen d'État unifié, vous devez d'abord vous rappeler que les oxydes qui peuvent réagir avec l'oxygène (parmi ceux que vous pouvez rencontrer dans l'examen lui-même) ne peuvent former que des éléments chimiques de la liste :
Les oxydes de tout autre élément chimique trouvé dans le véritable examen d'État unifié réagissent avec l'oxygène Ne fera pas (!).
Pour une mémorisation plus visuelle et pratique de la liste des éléments listés ci-dessus, à mon avis, l'illustration suivante est pratique :
Tous les éléments chimiques capables de former des oxydes réagissant avec l'oxygène (parmi ceux rencontrés à l'examen)
Tout d'abord, parmi les éléments répertoriés, il convient de considérer l'azote N, car le rapport de ses oxydes à l'oxygène diffère sensiblement des oxydes des autres éléments de la liste ci-dessus.
Il faut bien rappeler que l'azote peut former au total cinq oxydes, à savoir :
De tous les oxydes d'azote pouvant réagir avec l'oxygène seulement NON. Cette réaction se produit très facilement lorsque le NO est mélangé à la fois à de l’oxygène pur et à de l’air. Dans ce cas, on observe un changement rapide de la couleur du gaz de l'incolore (NO) au brun (NO 2) :
| 2NON | + | O2 | = | 2NON 2 |
| incolore | brun |
Afin de répondre à la question : est-ce qu'un oxyde d'un autre des éléments chimiques énumérés ci-dessus réagit avec l'oxygène (c'est-à-dire AVEC,Si, P., S, Cu, Mn, Fe, Cr) — Tout d'abord, vous devez vous en souvenir basiqueétat d'oxydation (CO). Les voici :
Ensuite, vous devez vous rappeler que parmi les oxydes possibles des éléments chimiques ci-dessus, seuls ceux qui contiennent l'élément à l'état d'oxydation minimum parmi ceux indiqués ci-dessus réagiront avec l'oxygène. Dans ce cas, l’état d’oxydation de l’élément augmente jusqu’à la valeur positive la plus proche possible :
| élément |
Le rapport de ses oxydesà l'oxygène |
| AVEC | Le minimum parmi les principaux états d'oxydation positifs du carbone est égal à +2
, et le plus proche positif est +4
. Ainsi, seul le CO réagit avec l'oxygène des oxydes C +2 O et C +4 O 2. Dans ce cas, la réaction se produit : 2C +2 O + O 2 = à=> 2C +4O2 CO2 + O2 ≠- la réaction est en principe impossible, car +4 – le plus haut degré d’oxydation du carbone. |
| Si | Le minimum parmi les principaux états d'oxydation positifs du silicium est +2, et le plus proche est +4. Ainsi, seul SiO réagit avec l'oxygène des oxydes Si +2 O et Si +4 O 2. En raison de certaines caractéristiques des oxydes SiO et SiO 2, l'oxydation d'une partie seulement des atomes de silicium dans l'oxyde Si + 2 O est possible. du fait de son interaction avec l'oxygène, il se forme un oxyde mixte contenant à la fois du silicium à l'état d'oxydation +2 et du silicium à l'état d'oxydation +4, à savoir Si 2 O 3 (Si +2 O·Si +4 O 2) : 4Si +2 O + O 2 = à=> 2Si +2 ,+4 2 O 3 (Si +2 O·Si +4 O 2) SiO 2 + O 2 ≠- la réaction est en principe impossible, car +4 – l’état d’oxydation le plus élevé du silicium. |
| P. | Le minimum parmi les principaux états d'oxydation positifs du phosphore est de +3, et le plus proche est de +5. Ainsi, seul P 2 O 3 réagit avec l'oxygène des oxydes P +3 2 O 3 et P +5 2 O 5. Dans ce cas, la réaction d'oxydation supplémentaire du phosphore avec l'oxygène se produit du degré d'oxydation +3 au degré d'oxydation +5 : P +3 2 O 3 + O 2 = à=> P +5 2 O 5 P +5 2 O 5 + O 2 ≠- la réaction est en principe impossible, car +5 – l'état d'oxydation le plus élevé du phosphore. |
| S | Le minimum parmi les principaux états d'oxydation positifs du soufre est de +4, et l'état d'oxydation positif le plus proche est de +6. Ainsi, seul le SO 2 réagit avec l'oxygène des oxydes S +4 O 2 et S +6 O 3 . Dans ce cas, la réaction se produit : 2S +4 O 2 + O 2 = à=> 2S +6O3 2S +6 O 3 + O 2 ≠- la réaction est en principe impossible, car +6 – le plus haut degré d'oxydation du soufre. |
| Cu | Le minimum parmi les états d'oxydation positifs du cuivre est +1, et la valeur la plus proche est positive (et la seule) +2. Ainsi, seul Cu 2 O réagit avec l'oxygène des oxydes Cu +1 2 O, Cu +2 O. Dans ce cas, la réaction se produit : 2Cu +1 2 O + O 2 = à=> 4Cu +2O CuO + O 2 ≠- la réaction est en principe impossible, car +2 – l'état d'oxydation le plus élevé du cuivre. |
| Cr | Le minimum parmi les principaux états d'oxydation positifs du chrome est +2, et le plus proche est +3. Ainsi, seul CrO réagit avec l'oxygène des oxydes Cr +2 O, Cr +3 2 O 3 et Cr +6 O 3, tout en étant oxydé par l'oxygène jusqu'au prochain (possible) état d'oxydation positif, c'est-à-dire +3 : 4Cr +2 O + O 2 = à=> 2Cr +3 2 O 3 Cr +3 2 O 3 + O 2 ≠- la réaction ne se déroule pas, malgré le fait que l'oxyde de chrome existe et dans un état d'oxydation supérieur à +3 (Cr +6 O 3). L'impossibilité de cette réaction est due au fait que l'échauffement nécessaire à son hypothétique mise en œuvre dépasse largement la température de décomposition de l'oxyde de CrO 3 . Cr +6 O 3 + O 2 ≠ — cette réaction ne peut en principe pas avoir lieu, car +6 est l’état d’oxydation le plus élevé du chrome. |
| Mn | Le minimum parmi les principaux états d'oxydation positifs du manganèse est de +2 et le plus proche est de +4. Ainsi, parmi les oxydes possibles Mn +2 O, Mn +4 O 2, Mn +6 O 3 et Mn +7 2 O 7, seul MnO réagit avec l'oxygène, tout en étant oxydé par l'oxygène jusqu'au prochain (possible) état d'oxydation positif , t.e. +4 : 2Mn +2 O + O 2 = à=> 2Mn +4O2 alors que: Mn +4 O 2 + O 2 ≠ Et Mn +6 O 3 + O 2 ≠- les réactions ne se produisent pas, malgré le fait qu'il existe de l'oxyde de manganèse Mn 2 O 7 contenant du Mn dans un état d'oxydation supérieur à +4 et +6. Cela est dû au fait que nécessaire pour une oxydation hypothétique ultérieure des oxydes de Mn +4 O2 et Mn +6 Le chauffage de l'O 3 dépasse largement la température de décomposition des oxydes résultants MnO 3 et Mn 2 O 7. Mn +7 2 O 7 + O 2 ≠- cette réaction est en principe impossible, car +7 – l'état d'oxydation le plus élevé du manganèse. |
| Fe | Le minimum parmi les principaux états d'oxydation positifs du fer est égal à +2
, et le plus proche parmi les possibles est +3
. Malgré le fait que pour le fer il existe un état d'oxydation de +6, l'oxyde acide FeO 3, ainsi que l'acide « fer » correspondant, n'existent pas. Ainsi, parmi les oxydes de fer, seuls les oxydes contenant du Fe à l'état d'oxydation +2 peuvent réagir avec l'oxygène. C'est soit de l'oxyde de Fe +2 O, ou oxyde de fer mixte Fe +2 ,+3 3 O 4 (échelle de fer) :
oxyde mixte Fe +2,+3 3 O 4 peut être oxydé en Fe +3 2 ou 3 :
Fe +3 2 O 3 + O 2 ≠ - cette réaction est en principe impossible, car Il n'y a pas d'oxydes contenant du fer dans un état d'oxydation supérieur à +3. |